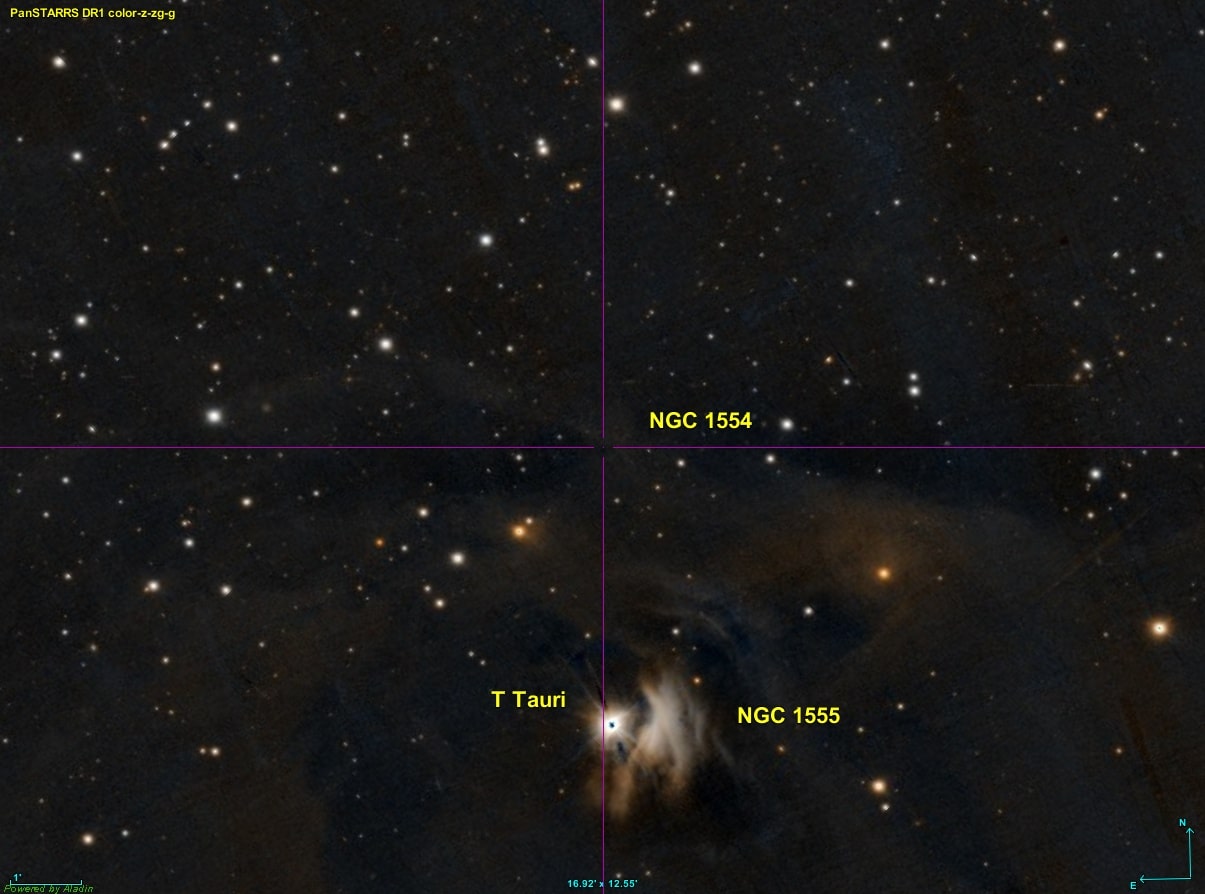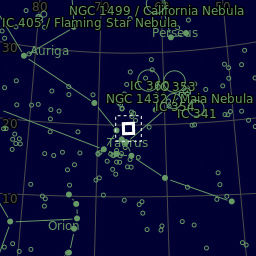Photons d’Or – Décembre 2025
L’image du mois Décembre 2025 La nébuleuse de l’Iris (NGC 7023) : une fleur parmi les poussières de Céphée, par la Team F.A.C.T. Pour clore cette année 2025 en apothéose, les Photons d’Or ont l’immense plaisir de récompenser une image