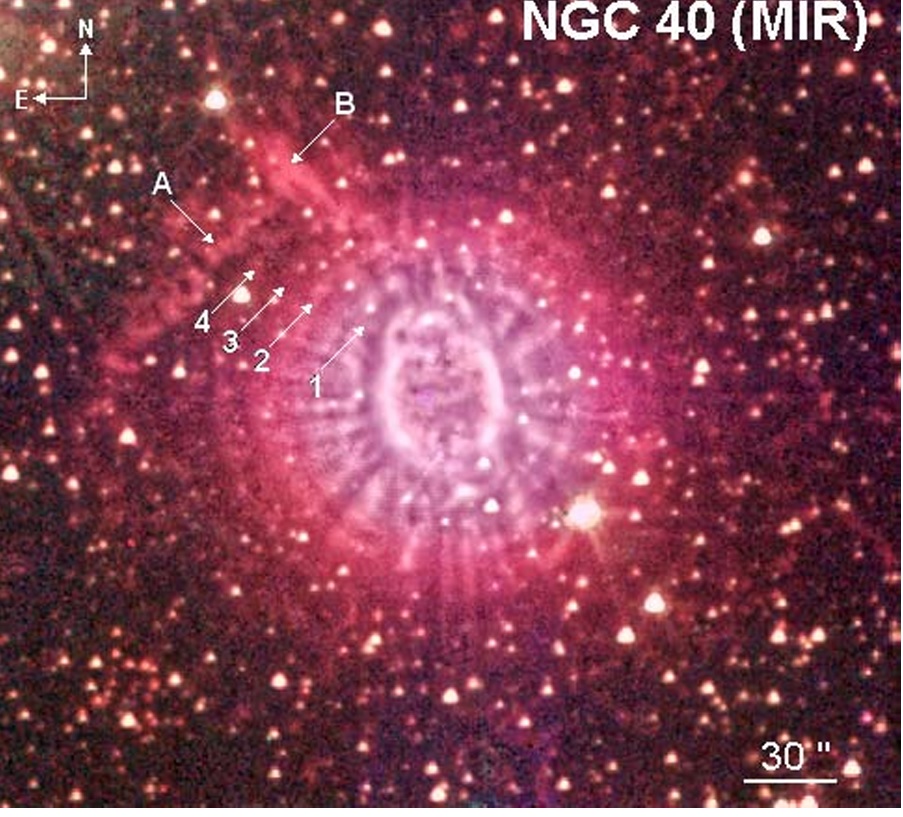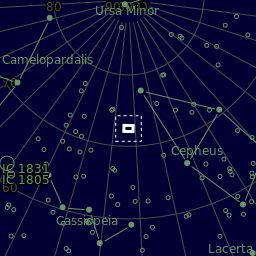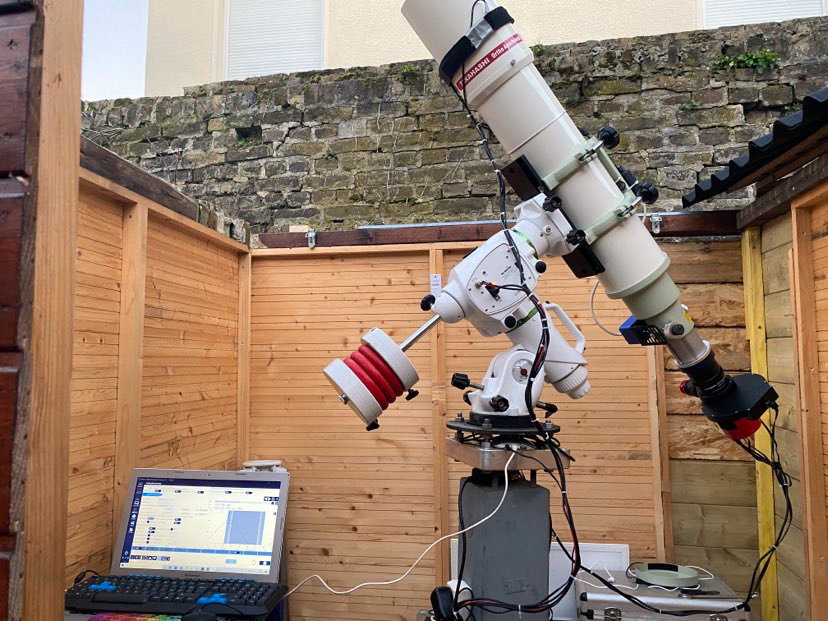Photons d’Or – Janvier 2026
L’image du mois Janvier 2026 La région d’Alnitak, berceau de la célèbre Tête de Cheval et de la Nébuleuse de la Flamme, par Julien DE WINTER et Landon BOEHM. Pour ouvrir cette nouvelle année 2026, les Photons d’Or récompensent une