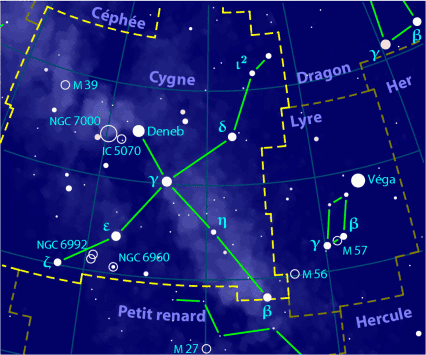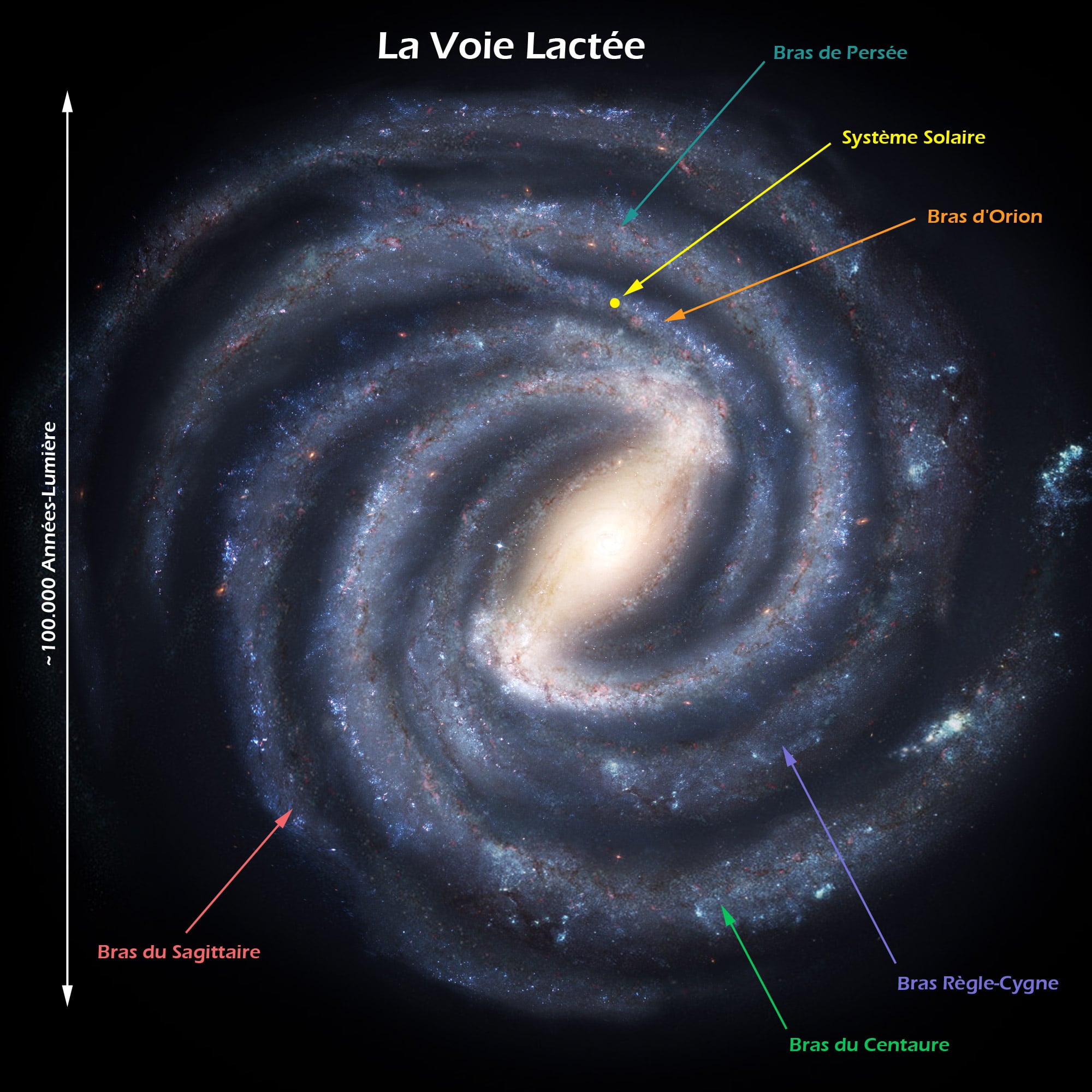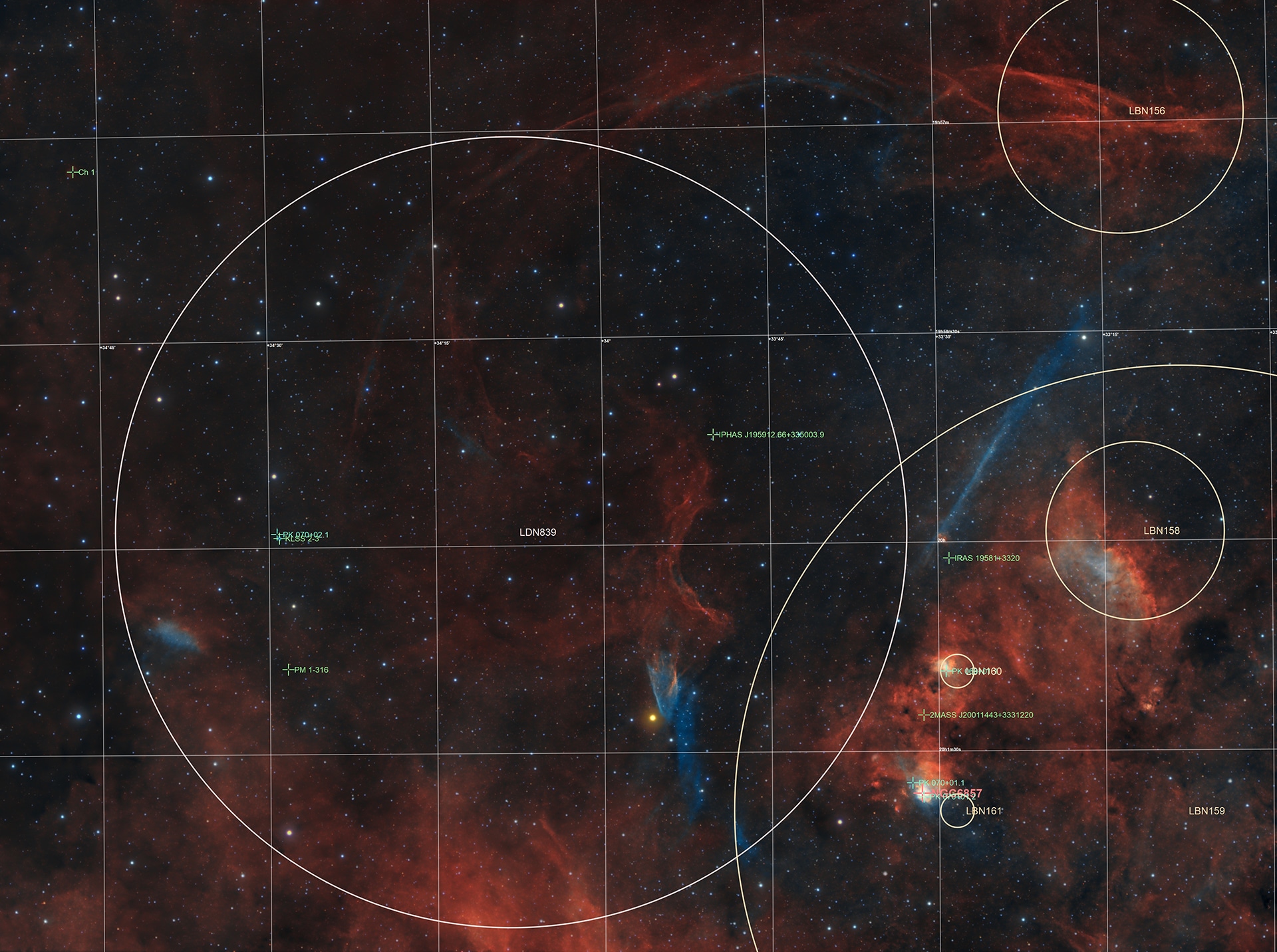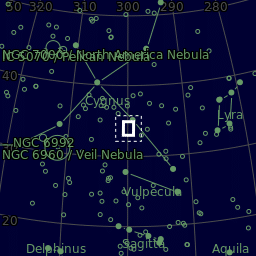Photons d’Or – Mai 2025
L’image du mois Mai 2025 La nébuleuse LDN 43, la « chauve-souris cosmique », par la Team CIEL AUSTRAL. Située dans la constellation du Serpentaire (Ophiuchus), LDN 43 est une nébuleuse obscure remarquable par sa silhouette évoquant celle d’une chauve-souris aux ailes